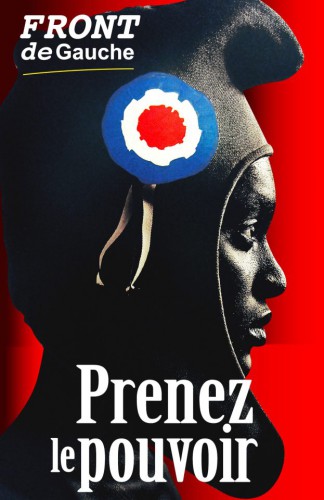Vous pouvez découvrir ci-dessous un point de vue de Robert Redeker, cueilli sur le site de Valeurs actuelles et consacré à Heidegger. Professeur de philosophie et essayiste, Robert Redeker a récemment publié Le soldat impossible (Pierre-Guillaume de Roux, 2014).

Heidegger et les antinazis de papier
À nouveau l’affaire Heidegger occupe les gazettes ! Cette histoire, répétée tous les dix ans, du nazisme de Heidegger — dont témoigne le livre de Peter Trawny, Heidegger et l’Antisémitisme (Seuil) — est un marronnier destiné à amuser ceux qui ne s’intéressent pas à Heidegger, qui ne le lisent ni ne le travaillent, ni ne travaillent avec lui. On ne voit pas quel est son intérêt, à part céder à la mode grotesque mais payante de l’antifascisme policier. Une fois que l’on a dit que l’homme Heidegger était nazi, on n’a rien dit du tout ! Ce n’est pas l’homme Heidegger dans son entier qui était nazi, encore moins le philosophe Heidegger, mais le particulier Martin Heidegger, à certains moments de son existence. Heidegger n’était pas “un” nazi, il était par moments nazi. L’article un est ici d’une importance capitale.
Quant à l’oeuvre philosophique de Heidegger, elle est simplement la plus géniale du XXe siècle, et de loin. Elle est par endroits, elle aussi, “dangereuse”. L’antiheideggérianisme de trop nombreux journalistes et de quelques philosophes en mal de succès est un antinazisme facile, un antinazisme de papier, qui, certes, pour les meilleurs, s’appuie sur une lecture du maître de Messkirch, sans s’accompagner néanmoins d’une méditation de cette pensée.
Le présupposé des commissaires du peuple ne laisse pas d’être inquiétant : les lecteurs de Heidegger sont des nazis en puissance, autrement dit ce sont des demeurés capables de se laisser contaminer ! Les chiens de garde chassant en meute Heidegger militent avec le même présupposé méprisant quand il s’agit de Céline, de Schmitt, de Jünger et d’Evola. (Carl Schmitt et Julius Evola, voire René Guénon et Ezra Pound sont des auteurs qui demandent de grands efforts à l’intelligence : le présupposé des policiers de la pensée tombe dès lors à côté de la plaque.)
Les vrais lecteurs de Heidegger savent que cette propagande facile s’attaque à un monstre qu’elle fabrique elle-même, « le sozi de Heidegger », selon la fine invention lexicale de Michel Deguy. Cette notion de “sozi”, amalgame sémantique de “sosie” et de “nazi”, est heuristique, conservant une valeur descriptive s’étendant bien au-delà du mauvais procès intenté au philosophe allemand. Elle est un analyseur de la reductio ad hitlerum appliquée aux auteurs que l’on veut frapper d’expulsion du champ de la pensée. Leo Strauss a pointé les dangers pour la vérité de la reductio ad hitlerum : « Nous devrons éviter l’erreur, si souvent commise ces dernières années, de substituer à la réduction ad absurdum la réduction ad hitlerum. Que Hitler ait partagé une opinion ne suffit pas à la réfuter. »
Une question s’impose : et si le prétendu nazisme de Heidegger fonctionnait un peu comme l’éloge de Manu, de la société de caste, de la chevalerie germanique, chez Nietzsche, c’est-à-dire comme une machinerie “inactuelle” destinée à exhiber autant qu’abattre “l’actuel”, le dernier homme, l’homme planétaire-démocratique ? Peut-être est-ce une stratégie philosophique de ce type-là qui se joue dans le prétendu nazisme de Heidegger ? Dans ce cas, ce qui paraît inacceptable chez Heidegger aux lecteurs superficiels, aux commissaires politiques de la vertu et au gros animal (l’opinion publique) acquiert le même statut philosophique que ce qui paraît inacceptable chez Nietzsche. Nos antinazis de papier — épurateurs de culture qui se comportent, en voulant exclure les ouvrages de Heidegger des programmes du baccalauréat et de l’agrégation, comme les destructeurs des bouddhas de Bâmyân — s’en rendront- ils compte ?
Robert Redeker (Valeurs actuelles, 12 novembre 2014)